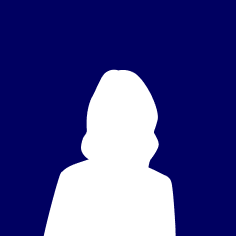Les chimères du transport durable

Le transport durable, entre véhicules bas-carbone, logistique optimisée et digitalisation, s’impose comme une priorité stratégique pour les entreprises. Mais derrière des promesses de technologies “vertes” et des discours ambitieux, certaines solutions relèvent parfois plus de l’illusion que de l’innovation. Entre contraintes opérationnelles, limites économiques et dépendance énergétique, le chemin vers un transport réellement durable est semé d’embûches.
Ces solutions proposées sont-elles efficaces, ou ne sont-elles que des illusions séduisantes ? Dans cet article, nous allons explorer, de manière succincte, les limites, les illusions et les pièges d’un transport dit « durable », en nous appuyant sur les enjeux concrets de la logistique et de la transformation des entreprises.
Panorama des solutions durables : des avancées limitées sur le terrain
L’électrification des flottes, l’hydrogène, les biocarburants ou encore les modes massifiés comme le rail et le fluvial sont souvent présentés comme les piliers du transport durable. Les progrès technologiques sont bien là : batteries plus performantes, recherches sur l’hydrogène vert, motorisations plus sobres. Pourtant, leur adoption reste limitée dans les chaînes logistiques.
En France, en 2024, seules 25 % des grandes entreprises respectent les quotas de véhicules électriques ou hybrides imposés par la loi d’orientation des mobilités (LOM), selon une étude publiée en février 2025 par l’ONG Transport & Environment.
Différentes causes : les réseaux de bornes de recharge sont inégalement répartis, les capacités de production d’électricité bas-carbone sont encore insuffisantes, et l’approvisionnement en matériaux critiques (lithium, cobalt, nickel, etc.) constitue un frein important. L’électrification du transport, en particulier, n’est réellement pertinente que si elle s’appuie sur une énergie décarbonée. Or, dans de nombreux pays, le mix énergétique reste dominé par des sources fossiles. Résultat : une électrification qui peut déplacer le problème sans le résoudre.
Autre limite souvent sous-estimée : la gestion du cycle de vie. La production et le recyclage des batteries posent des défis majeurs en matière d’impacts environnementaux et de traitement des déchets. Une solution qualifiée de “verte” peut générer d’autres formes de pollution si elle n’est pas pensée dans une logique circulaire, incluant fabrication, usage et fin de vie.
Côté modes alternatifs, la situation n’est pas plus avancée. En France, par exemple, la part du fret ferroviaire stagne autour de 9 %, et le fluvial reste marginal. Ces options souffrent d’un manque d’investissements, d’infrastructures et d’intégration dans les schémas logistiques existants. Un de nos articles traite de ces alternatives au transport routier.
Des difficultés de mise en œuvre à plusieurs niveaux
Passer à un transport plus durable demande des investissements importants : renouveler les véhicules, adapter les infrastructures, mettre en place des outils de suivi ou mutualiser les flux. Ces efforts, bien que nécessaires, ne sont pas toujours rentables à court terme.
Les grandes entreprises ont souvent les moyens d’engager ces changements, grâce à leur solidité financière et parfois au soutien d’aides publiques. En revanche, les PME et les sous-traitants, plus fragiles, peinent à suivre. Beaucoup doivent reporter ou abandonner leurs projets, faute de budget.
Ce déséquilibre crée une supply chain à deux vitesses : les acteurs bien équipés avancent, les autres restent en difficulté. D’autant plus que les organisations logistiques actuelles, pensées avant tout pour l’efficacité économique, sont difficiles à faire évoluer. Réorganiser les flux ou intégrer de nouveaux modes de transport demande un effort collectif que peu peuvent porter seuls.
Enfin, mesurer réellement l’impact environnemental reste un défi. Chaque entreprise suit ses propres indicateurs, les données sont souvent incomplètes, et il n’existe pas de référentiel commun. Sans outils partagés, il est difficile de faire de la durabilité une réalité concrète au quotidien.
L’illusion technologique : un levier utile, mais loin d’être suffisant
La technologie est souvent perçue comme une solution miracle pour rendre les transports plus durables. Des outils comme l’intelligence artificielle, la robotique ou les jumeaux numériques permettent d’optimiser les flux logistiques. Mais leur impact environnemental réel reste limité s’ils ne s’accompagnent pas d’un changement en profondeur des pratiques.
Par exemple, l’IA peut réduire les kilomètres parcourus, mais si les véhicules restent polluants, le gain reste marginal. Autrement dit, la technologie est un levier utile, mais elle ne remplace pas les transformations structurelles nécessaires.
Enfin, la donnée, pourtant clé, est encore peu exploitée. Traçabilité, calcul d’émissions, anticipation : les outils existent, mais les entreprises peinent à les activer pleinement, faute de compétences, de temps ou de solutions adaptées. Le véritable enjeu reste de passer de l’analyse à l’action.
Conclusion
Le transport durable est plus qu’un objectif louable : c’est une nécessité. Mais derrière les promesses technologiques et les annonces ambitieuses, les réalités logistiques, économiques et opérationnelles rappellent que la transition ne s’improvise pas.
Face aux illusions et aux freins persistants, il devient essentiel d’adopter une approche lucide et ancrée dans les contraintes du terrain. Le véritable défi n’est pas d’imaginer le transport de demain, mais de le rendre viable, cohérent et durable aujourd’hui.
Pour aller plus loin :
- AMCS, Les trois principaux défis du transport durable
- Findle, 3 pistes d’améliorations pour un transport durable
 Gaspard
Gaspard